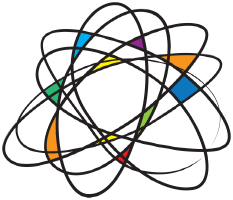Le travail, pour quoi faire ?
Pour quoi travaillez-vous ? Pour avoir une identité sociale, un statut, pour tisser des liens, pour apprendre, développer un savoir-faire, pour être utile, créer du beau, ou en vue de subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille ?
A l’heure où l’on parle de « grande démission » et de « démission silencieuse », où des employeurs peinent à recruter des salariés qualifiés, où d’autres misent sur l’intelligence artificielle pour remplacer ou seconder l’humain, où le chômage persiste et où l’âge de la retraite va bien finir par reculer, la notion de travail semble vivre, plus que jamais, un vrai paradoxe.
L’énigme à résoudre se résume à la double question : ça veut dire quoi travailler ? Et pour quoi travaillons-nous ?
«Savoir-faire, effort et utilité forment le triptyque moral de la valeur travail. »
Au sens large, le travail peut être défini comme un ensemble d’activités coordonnées de production de biens ou de services. Cette définition inclut le travail rémunéré ou non, humain ou non humain, visible ou invisible. En effet, si le travail salarié ou facturé peut être facilement traçable (et intégré au calcul du PIB), qu’en est-il du travail gratuit des bénévoles, des stagiaires, des blogueurs, des tâches ménagères ou des aidants familiaux ? Qu’est-ce qui est du travail et qu’est-ce qui n’en est pas ? Les abeilles dans leur mission vitale de pollinisation travaillent-elles ? Les robots conçus pour accomplir automatiquement des tâches travaillent-ils ?
On voit que la notion de travail dépasse largement la définition économique et celle du marché de l’emploi. D’ailleurs le premier sens du mot ne s’applique-t-il pas au stade de l’accouchement pendant lequel se produisent les contractions ?
Si on nous pose la question, nous répondons généralement estimer travailler lorsque nous nous employons dans des activités qui requièrent un certain savoir-faire et un effort, qui sont utiles à quelqu’un et produisent de la valeur en contrepartie de laquelle nous recevons une rétribution. Ces trois notions, savoir-faire, effort et utilité forment le triptyque moral de la valeur travail. Le trouble provient de l’identité du bénéficiaire de l’utilité de notre travail. A qui « ça » profite vraiment ?
Ce qui au départ était relié à notre simple mode d’existence et au déploiement de la vie (comme la recherche des moyens de subsistance des chasseurs-cueilleurs) subit un processus d’organisation sociale au fil des siècles qui empile les injonctions économiques, politiques et religieuses au fur et à mesure des époques. On assiste ainsi à un phénomène de moralisation du travail qui accompagne la justification de l’appropriation de ses fruits.
« Donner au travail une place moins centrale favoriserait une vie plus équilibrée. » – Dominique Méda, sociologue
Aujourd’hui la question qui se pose est celle de notre relation au travail et de la place que la société lui donne dans la vie des citoyens. Cette affaire est éminemment culturelle puisque le rôle assigné au travail est divers selon les pays au sein même de l’Europe. Selon Dominique Méda, philosophe et sociologue, spécialiste des politiques sociales, les Français accordent plus d’importance à leur activité professionnelle (y compris ceux qui n’en n’ont plus comme les chômeurs ou les retraités) qu’en Allemagne ou en Angleterre où la perception du travail est davantage contractuelle. Les pays latins comme la France sont des sociétés de « statut » dans lesquelles le travail est un marqueur social et identitaire extrêmement puissant. Donner au travail une place moins centrale favoriserait une vie plus équilibrée (comme dans les pays nordiques où la vie communautaire et la nature tiennent une place primordiale), diminuerait la pression sociale sur les chômeurs et permettrait paradoxalement de travailler plus longtemps et en meilleure santé.
La période Covid avec ses confinements, déconfinements, généralisation du télétravail a fortement perturbé les équilibres déjà fragiles de l’organisation du travail et fragmenté le corps social dans les entreprises. Ainsi la « centralité » de la sphère professionnelle dans la vie des individus est profondément questionnée au regard de la qualité des conditions de vie et du sens véritable attribué à l’engagement personnel. Contrairement aux idées reçues, les jeunes générations ne sont pas moins engagées dans leur travail mais probablement plus lucides et plus critiques quant aux impacts de leur activité sur leur vie et sur celle des autres.
Au sein des entreprises, si on évalue le niveau d’engagement des collaborateurs au volume d’heures de présence sur le lieu de travail ou au temps de connexion à domicile, on passe totalement à côté des critères d’efficacité, de créativité, de curiosité et d’ouverture qui peuvent se cultiver hors les murs. Un salarié est avant tout un acteur inséré dans la société au-delà de sa seule entreprise, ce qui exige du temps et de la disponibilité pour participer et contribuer à des actions citoyennes, sociales, artistiques ou culturelles. Le paysage associatif en France est foisonnant d’initiatives, d’idées, de coopérations, de réflexions, d’expérimentations et de solidarités qui prouvent la vitalité des acteurs sur les territoires. Par ailleurs, le besoin de se former tout au long de la vie professionnelle conduit de plus en plus d’adultes à s’orienter vers des formations plus ou moins longues, certifiantes ou non, pendant ou en dehors du temps de travail, afin d’assurer leur employabilité sur la durée.
On comprend mieux le phénomène actuel de « démission silencieuse » qui se manifeste par un retrait d’énergie, tant physique que psychique, investie exclusivement au bénéfice de l’employeur pour la réinvestir ailleurs dans le champs de la famille, du bénévolat, de l’engagement politique, de la reconversion professionnelle ou de l’entrepreneuriat. De plus en plus de jeunes salariés développent des « side projects » soit des projets en parallèle de leur job principal, exprimant ainsi leurs talents cachés, enrichissant leur expérience et préparant parfois leur envol futur.
Alors est-ce la fin du travail ? Certainement pas. Il s’agit plutôt d’une réassignation de la place du travail dans la vie des personnes et au sein de la société. Car si l’on considère l’activité professionnelle comme un levier d’émancipation économique, d’épanouissement personnel et de contribution au collectif, certains facteurs de réussite deviennent incontournables. Le premier d’entre eux est la revalorisation des métiers déconsidérés depuis longtemps et qui sont pourtant des métiers en tension et cruciaux pour les prochaines années. Souvent liées aux professions du soin et de l’éducation, ces activités à majorité féminine représentent à elles seules le paradoxe de la réalité du travail : un engagement personnel élevé pour une rétribution économique souvent faible. Par ailleurs, la meilleure incitation à retrouver un emploi pour un chômeur reste encore la perspective d’être correctement rémunéré. Le maintien dans la précarité n’a jamais motivé personne. Comment peut-on affirmer la revalorisation du travail si ce travail « ne vaut rien » ?
Sur le plan de la motivation intrinsèque, le facteur le plus souvent cité est celui de l’autonomie qui va de pair avec la confiance accordée dans les compétences et le savoir-faire des individus et du collectif. La marge de manœuvre et le pouvoir d’initiative personnelle deviennent une reconnaissance en soi. L’autre facteur est lié au rythme et à la continuité de l’action. Pouvoir réaliser une tâche du début à la fin sans être interrompu ou chronométré et pouvoir apprécier le résultat du travail constitue la plus grande satisfaction des travailleurs que ce soit le conseiller clientèle, le développeur informatique ou la responsable juridique. Un processus de production ou de décision hyper fragmenté où l’on est exclu de la réalisation finale devient extrêmement frustrant et ôte tout sens à l’action. Finalement, plus que le travail en lui-même, ce qui génère le malaise contemporain, c’est la dégradation des conditions d’exercice de celui-ci : manque de moyens, pression sur le temps alloué, organisation dysfonctionnelle, dislocation de la communauté de travail et des liens de solidarité.
« Faire la distinction entre labeur et œuvre. »
D’où le retour des métiers manuels. Souvent dévalorisés en France qui privilégie les professions dites « intellectuelles », les métiers de l’artisanat et de l’agriculture reviennent sur le devant de la scène, attirent les jeunes et les moins jeunes en recherche de reconversion. Métiers de bouche, métiers du bois, de la terre ou du fer, les artisans travaillent la matière, approfondissent la maîtrise du geste dans la durée. On parle d' »intelligence de la main » qui en réalité fait appel à tous les sens en éveil, à l’intuition et à la créativité et redonne du sens et du plaisir à l’activité du faire.
« Quand pour passer une journée devant un ordinateur, il faut parvenir à oublier son corps mal assis et impatient, quand nos sensations quotidiennes se réduisent le plus souvent à la vitre du téléphone et au plastique du clavier, il y a quelque chose de déroutant et de formidablement enrichissant dans le fait d’utiliser ses mains, sa vue, son ouïe et même son nez » nous dit Arthur Lochmann, étudiant en philosophie devenu charpentier, auteur de « La Vie solide : la charpente comme éthique du faire » (Payot 2019).
L’acquisition d’un savoir-faire unique faisant suite à l’apprentissage auprès de maîtres artisans et à des années de pratique donne un sentiment de sécurité dans le travail, d’accomplissement personnel et trouve son aboutissement dans la transmission de ses savoirs à de nouveaux apprenants. Le sentiment d’appartenance à une communauté professionnelle unie par des valeurs communes renforce l’identité par l’histoire du métier entre tradition et innovation, hors de tout élitisme et distinction sociale.
Parmi les penseurs du travail, la philosophe Hannah Arendt a souligné la nuance signifiante entre labeur et œuvre. Au-delà de la tâche et de la production qui relèvent du labeur, à quoi œuvrent les humains ? Quel est leur but ultime ?
Faire société, c’est œuvrer au bien commun, autrement dit contribuer à ce qui est inappropriable par essence (comme l’air ou la santé) ou par convention et c’est peut-être à ce niveau que se situe la valeur « morale » ou « éthique » du travail. Aujourd’hui les défis sociétaux sont avant tout écologiques et sociaux. La question de la préservation des moyens de subsistance et d’habitabilité de la planète devient centrale. Comment notre travail, quelle que soit sa forme, rémunérée ou gratuite, visible ou invisible, peut-il œuvrer à l’émergence de solutions nouvelles ?
Et vous, à quoi et comment œuvrez-vous ?
Sources : La valeur travail, de l’idéologie à la réalité – Julien de Sanctis – iphilo mai 2015
Zadig numéro 3 (2019) – Le travail, pour quoi faire ?
ARTE – Les idées larges – « Travailler a-t-il un sens ? » avec Marie-Anne Dujarier
Crédits Photos Pixabay et Freepik